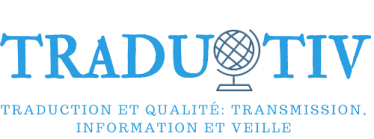Les deux, en vérité, tout est question de temporalité. Cette bande dessinée japonaise était dans les premiers temps désignée au féminin à la fin du 19è siècle. Puis, dans les années 90, lorsque le manga a conquis les écrans sous forme de dessines animés et pris pied dans les librairies francophones au format de poche que l’on connait si bien, il a été désigné au masculin dans les magazines spécialisés. Cet usage reste majoritaire aujourd’hui.
Les mangas sont traduits en nombre depuis les années 90, ils représentent depuis plusieurs années environ 40 % des ventes de B.D. en France et en Belgique, et la francophonie représente le deuxième plus gros marché de vente de mangas après le marché japonais*. Nous sommes donc à trente ans de pratique de la traduction des mangas. Entre-temps, les a priori ont évolué. On se rappelle que plusieurs titres phares des années 90 voyaient leur planche retournées pour accommoder le sens de lecture française, de gauche à droite et les noms des personnages francisés.
Dès les premiers temps forts, la synergie entre format télé et format papier a renforcé la diffusion du manga. Les ventes de manga ont connu un boum en 2019, soutenues par l’arrivée massive de contenu sur les plateformes de streaming. La crise de Covid n’a en rien entamé l’élan, au contraire, les mangas et animés ont servi de refuges pendant les confinements.
En trente ans, le public francophone s’est familiarisé au format et aux noms japonais. Plusieurs concepts, un temps spécifiquement nippons, se passent désormais d’explications. Pour autant, aujourd’hui encore la distance culturelle entre le français et le japonais présente des défis importants aux traducteur.ices. Outre les difficultés inhérentes aux différences de construction des deux langues, notamment l’absence de genre et de nombre en japonais, il existe également une grande distance culturelle. Autant la francophonie se nourrit de racines greco-romaines et de christianisme, autant le Japon puise ses sources dans le shintoïsme, le bouddhisme ou encore le confucianisme.

Les notes de bas de page et lexiques sont fréquents pour le plus grand plaisir des lecteur.ices. Personnellement, ceux de Great Teacher Onizuka, un manga de Tôru Fujisawa sur un ancien délinquant à moto devenu inopinément prof de lycée, restent gravés dans ma mémoire comme une ouverture sur le monde, une promesse d’ailleurs.
Bref, traduire des mangas implique de nombreux choix qui sont propres à chaque traducteur et traductrice de même qu’à chaque maison d’édition, collection et genre. La traduction s’inscrit dans un cadre spécifique qu’il faut chercher à comprendre. Si certaines pertes sont inhérentes, n’oublions pas qu’elles le sont dès la lecture. Chaque auteur et chaque autrice utilisent des références culturelles qui ne seront pas forcément comprises par la totalité du lectorat.


Le travail des traducteurs.ices est récompensé et mis en valeur depuis 2017 par le prix Konishi de la traduction de mangas auquel les traductrices présentes à la Foire du Livre de Bruxelles ont été nommées, Manon Debienne, en collaboration avec Sayaka Okada pour Takane & Hana de Yuki Shiwasuen 2017 et Aline Kukor pour Otaku Otaku de Fujita en 2019.
Pour revenir avec elles sur leur travail, trois questions :
Quelle série vous a donné le plus de fil à retordre ?
M. Debienne : Sket Dance, découvert quand j’étais éditrice chez Kazé manga, c’est une série bourrée d’humour, de jeux de mots renvoyant au dessin et de référence culturelles. Plusieurs traducteurs s’y sont cassé les dents, et je l’ai finalement reprise avec Sayaka, ma partenaire de traduction depuis les bancs de la fac.

Dans cette série, je tenais absolument à éviter les notes de bas de page et à trouver la pirouette, il fallait toujours faire preuve de créativité pour retomber sur ses pattes. Je me rappelle un chapitre où des personnages avait organisé une série d’énigmes. Chaque énigme avait pour clé un hiragana (ndr : une des syllabes de l’alphabet japonais) qui composait un message, l’enjeu était de les remplacer par des lettres et de créer un mot.

Parfois, mais c’est rare, la maison d’édition impose une démarche. Par exemple, dans Nekogahara, une histoire où des chats forment une société parallèle à la société humaine au 17è siècle au Japon, chaque personnage a un nom faisant référence à son pelage, son rang ou sa race. J’étais partante pour les traduire, mais l’éditeur a refusé, et j’ai fini par créer à un lexique. Le problème du lexique est qu’il faut potentiellement le soumettre aux maison d’édition japonaises pour validation.
A. Kukor : Je dirais Moon lost – Une nuit sans lune, de Yukinobu Hoshino. Tout simplement car c’est une série de science-fiction qui parle beaucoup de physique, et que c’est un domaine que je ne maîtrise absolument pas.

J’ai dû beaucoup me renseigner sur la théorie des cordes, les branes, les trous noirs, les dimensions spatiales, le fonctionnement d’un accélérateur de particules, etc. Pour bien traduire quelque chose, il faut être sûr de bien le comprendre. Et j’avoue que cette série a été un très gros morceau ! Sur ce titre, je travaillais en binôme avec une adaptatrice qui faisait aussi ses recherches de son côté. Cela nous a permis d’en discuter et de mieux comprendre le sujet.
Quelle série vous a fait réfléchir sur votre propre perception des choses ?
M. Debienne : Les titres autobiographiques de Kabi Nagata, publiés chez Pika dans la collection Pika Graphic. Les sujets sont tellement personnels et sensibles que je suis particulièrement attentive à rester proche de ses formulations et de ses choix de mots. Je cherche constamment à recréer l’effet qu’elle cherche à produire, notamment lors d’une scène où elle décrit une aggression sexuelle subie dans l’enfance. Autant j’aurais personnellement tendance à éviter des formulations qui responsabilisent l’enfant pour l’acte subi, autant c’était le discours tenu en japonais, et j’ai dû m’y tenir. Le fil est ténu entre la nécessité d’adapter au public francophone et celle de refléter une société différente de celle dans laquelle on vit. Pour cette scène, nous avons inséré un message de sensibilisation sur la question des violences sexuelles.
A. Kukor : L’enfant en moi de Mamoru Aoi. C’est une série qui parle de la grossesse accidentelle d’une adolescente et qui a pour vocation d’aborder l’éducation sexuelle au sens large.

On considère souvent le Japon comme un pays « plus évolué » que le nôtre (Belgique ou France), mais je me suis rendu compte que, sur certains plans du domaine de la santé, il était en réalité moins avancé. Ce que l’on prend pour acquis chez nous ne l’est pas forcément ailleurs. Notamment les remboursements de soins de santé, l’accès à la contraception ou à la pilule du lendemain, les méthodes d’I.V.G., et surtout, les connaissances en matière d’éducation sexuelle. Même s’il reste beaucoup d’aspects à améliorer chez nous, j’ai pu constater que c’était bien pire au Japon !
Comment décidez-vous des termes à expliquer ou non ?
M. Debienne : Je me pose plusieurs questions. Quel est le lectorat ? A quel genre appartient le manga ? Dans quelle collection sera-t-il publié ? Par exemple, si le manga est destiné à des enfants, je traduis au maximum. Par contre, si la série est destinée à un public de connaisseurs, je garde certains termes japonais. Pour l’humour, je tiens à trouver des pirouettes, sans passer par des notes de bas de page.
A. Kukor : Tout dépend de la série en question. Il faut voir si laisser le terme en japonais avec une note est plus pertinent que de le traduire directement. Pour la série Otaku Otaku, par exemple, on a volontairement laissé plus de termes japonais qui sont propres à l’univers « otaku » et gardé le côté réaliste des discussions passionnées, et pour que les « otaku » de chez nous se retrouvent bien dans la série (tout en mettant des notes pour les non-initiés).
Et puis, les langues évoluent constamment. Chaque année, de nouveaux mots sont ajoutés dans le dictionnaire, ce qui est parfois le cas de mots d’origine japonaise. Par exemple, aujourd’hui, le mot « bento » est dans le Larousse. Je pars du principe que si un mot se trouve dans notre dictionnaire, il n’est plus forcément nécessaire de mettre une note.
Soizic Schoonbroodt, responsable du département de japonais à la Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’Université de Mons et traductrice de mangas
*Voir les chiffres du cabinet d’analyse Gfk, https://www.gfk.com/fr/insights/BD-ne-connait-pas-la-crise
Photo Bandeau © Guillaume Hennebert HELB Photo pendant la Foire du livre de Bruxelles au « Quartier Manga »