
Il y a tout juste une semaine, le jeudi 25 novembre, l’asbl TraduQtiv fêtait ses 5 ans d’existence. Le cadre somptueux ( La Bellone), les ballons, les bulles, les invités, les petits fours, tout était réuni pour une très belle fête d’anniversaire. Et le cadeau était à la mesure: une conférence d’une star de la traduction, Nicolas Richard.

Vous auriez voulu y être? Vous avez des regrets? Qu’à cela ne tienne! Voici quelques photos et, surtout, le texte intégral de la conférence de Nicolas Richard. Ce n’est pas un vrai beau cadeau d’anniversaire, ça?
Lire, traduire et écrire, une même flamme ?
Avant toute chose, un grand merci à Anne Casterman, qui a eu la gentillesse de m’inviter ici, à Bruxelles, c’est un plaisir immense – je dirais presque un « enjoiement » – de prononcer ces quelques mots devant vous ce soir.
Avertissement. Comme pour les produits alimentaires, il me semble correct de vous prévenir en mentionnant les ingrédients ayant été utilisés pour l’élaboration du produit. Donc : ce discours comporte deux anecdotes anglaises, des références à des livres par bottes de trois, quelques citations incrustées ; un aveu peu glorieux divulgué publiquement pour la première fois, une chanson d’un Ostendais datant de 1983 ; six calembours.
Qu’est-ce qui fait que je suis devenu traducteur ? Je peux chercher une explication du côté familial : dans ma famille, schématiquement, la branche paternelle, c’est la science ; la branche maternelle, la couture. Mon grand-père paternel était ingénieur — il aurait été l’inventeur, selon la légende familiale, de ces boules que l’on voit fixées aux fils (FILL) haute tension dans nos campagnes et le long de nos routes nationales. Déjà à ce stade de ma généalogie, voilà du fil qu’il faudra sans doute retordre. Mon père, aujourd’hui à la retraite, a toute sa vie été chercheur en hautes températures. Plutôt physicien / chimiste, mais en réalité je n’ai jamais compris ce qu’il fabriquait dans son labo, à Orléans La Source, dans le Loiret. Alors, justement, est-elle là, la source, dans la branche paternelle scientifique ? La source de la « traductivite » que j’ai contractée ? Où est-elle à chercher plutôt côté maternel ? La mère de ma mère était couturière, elle travaillait chez elle, elle recevait des clientes – il y avait un mètre ruban à portée de main, des aiguilles plantées dans une boule de tissu, des dès à coudre… et je me souviens encore des termes qui enveloppait son activité : les essayages, les patrons (ces modèles de papier ou de toile permettant de reproduire la forme des différentes pièces d’un vêtement aux mesures exactes). Ma grand-mère n’était pas employée ; elle était son propre patron. Ma mère aussi était couturière ; elle avait trois fils (FISS), à qui, durant leur enfance et leur adolescence, elle a tricoté des pulls, cousu des habits, reprisé des pantalons. Donc, ne pas « partir au travail » le matin, mais y être déjà, ne pas sortir de la maison pour gagner sa vie mais être dans la place dès potron-minet, c’est une pratique qui existe dans ma famille depuis déjà deux générations ; en un sens, ma grand-mère couturière travaillait déjà « en distanciel ». Je revois encore ma mère devant sa machine à coudre. Une Singer. Quand j’étais petit on prononçait « singère ». En anglais c’est singer, comme singer in a band, la chanteuse ou le chanteur. Et si, à défaut de chan-tonner, je me can-tonne au français, c’est le verbe singer : imiter de manière caricaturale en contrefaisant des gestes, des attitudes, la voix. Eh bien voilà : nous y sommes, aux antécédents possibles de ma « traductionnite » : la recherche, les températures hautes, la couture, le tricotage, l’ouvrage, le rapiéçage, l’imitation, le chant, la voix.
Il y a deux semaines, j’étais chez une cousine anglaise, dans le borough du Grand Londres qui s’appelle Enfield (333 000 habitants). Elle a deux enfants assez jeunes, 6 ans et 1 an et demi, j’y étais avec mon fils (FISS) pendant les vacances scolaires, et nous avions un boulot dingue, lui pour l’école (il est en classe préparatoire, comme on dit en France) et moi pour une traduction pour laquelle, justement, je n’avais peut-être pas suffisamment soigné la phase dite préparatoire. Il se trouve que le mari de la cousine était malade, alité, fiévreux. Nous étions contents de passer du temps avec cette branche anglaise de la famille, mon fils et moi, mais au bout d’une heure, le premier matin, nous avons compris qu’avec les deux charmants bambins, question calme, nous allions devoir faire tintin, ce serait plutôt L’Oreille cassée que le Motus Bleu. Nous nous sommes rendu compte qu’il ne serait pas possible de travailler dans une petite maison où il y a un garçon, adorable au demeurant, mais qui avec un très haut niveau d’énergie, et qui tousse beaucoup ; et une petite fille, adorable au demeurant, mais qui recèle en elle la quantité d’électricité des 7 boules de Cristal, et qui, de surcroit, n’arrête pas de tousser. Bon. Bref. Le matin même, mon fils et moi décidons de ne pas trop déranger notre sympathique famille d’accueil et nous nous rendons à la British Library où, après une quarantaine de minutes de trajet, avec un changement à Seven Sisters, nous obtenons une carte nous permettant d’accéder aux salles de lecture, frappée de la mention : « British Library – For research, inspiration and enjoyment ». Et, de fait, c’est infiniment inspirant de se retrouver au milieu des livres, au calme, et c’est vrai que nous avons vraiment enjoyé. En tout cas, oui, cela nous mettait « en joie » de pouvoir avancer sur nos projets dans un silence propice à la réflexion. Ce qu’il faut savoir sur mon fils c’est que, depuis tout petit, il a toujours refusé de lire. On a tout tenté, pour lui donner goût à la lecture. Il a grandi dans une maison où, il faut le reconnaître, il y a pas mal de livres. Il y a a toutefois UN mur chez nous qui n’est pas recouvert de livres, c’est celui de la porte d’entrée. Il est plus pratique, pour ouvrir la porte et la refermer, qu’il n’y ait PAS de rayonnages bloquant le mouvement du battant. Sa mère et moi lui avons acheté des classiques, des modernes, des tout petits livres, des gros livres rigolos avec des illustrations, des mangas en feuilletons qu’on lit en partant de la fin, des aventures palpitantes qui parlaient de football, parce qu’il aimait jouer au foot : mais en fait, ce qui se passait, c’est que ce type de fiction l’ennuyait, il n’avait pas envie de lire des histoires « qui ne sont pas vraies » (ce sont ses mots). Pour autant, il n’avait pas véritablement d’aversion pour le livre en tant qu’objet. Petit, même, il s’en servait pour ses cabanes dans sa chambre. Quand il se bâtissait des abris avec les draps et les couvertures, lorsqu’il s’agissait de faire tenir les bords d’édredons de sa tente, sous son bureau, il savait utiliser à bon escient les livres les plus lourds, au format brique. C’est ainsi que très jeune il a su reconnaître Fear and Loathing de Hunter S Thompson, (757 pages), et surtout son préféré : Against the Day de Thomas Pynchon, (1085 pages). Mais là, il y a deux semaines, dans la bibliothèque londonienne, j’ai eu comme une révélation : ce garçon qui n’a jamais voulu lire, assis devant moi — mais décalé de deux rangs, pour garder ses distances, tout de même — est en train de se régaler parce qu’il peut LIRE au calme. L’aller-retour Enfield-Charing Cross nous a coûté TROIS LIVRES, et c’est précisément la formule qui décrit ce que mon fils a devant lui, en plus des feuilles et du crayon de papier : TROIS LIVRES ouverts dans lesquels il puise ses exercices :
Les Contre-exemples en mathématiques de Bertrand Hauchecorne (ellipses)
Maths MPSI, Tout-en-un, Dunod, (1560 pages)
Physique, les mille et une questions en prépa, ellipses, (852 pages)
D’ailleurs. . . comment les traduire vers l’anglais, les TROIS LIVRES que m’a coûté le trajet et les trois objets avec pages que mon fils a sur sa table à la British Library ? Nous voilà face à des pounds et des books. En passant du français à l’anglais, l’homophonie s’est perdue. Et puis finalement, que fait-il, ce garçon-qui-n’a-jamais-lu-un-roman, si ce n’est traduire dans une langue qui m’est presque inconnue – les mathématiques — des intitulés qui me sont incompréhensibles ? Devant cette discipline qu’il explore, je ne peux que rester à la porte d’entrée, comme si l’absence de savoir de ma part était un mur de livres qui m’empêchait d’actionner le battant ; je ne peux pas pénétrer dans son univers aux formules si évocatrices que je ne résiste pas à la tentation de citer quelques têtes de chapitres : anneau des polynômes à coefficient dans un anneau commutatif ; divisibilité dans un anneau intègre ; mise en défaut de certains critères de convergence (in Séries numériques) ; monotonie et continuité (in Fonctions d’une variable réelles monotones, périodiques, convexes, bornées) ; séparation (in Tolopogie générale) ; compacité (in Tolopogie générale) ; boules (in Espaces Métriques).
À son rythme, inventant sa propre métrique, mon fils avance dans une forêt, passant d’arbre en arbre en utilisant comme un système de lianes — à sa façon il tire des fils (FILL). Tenez, quand je dis « mon fils/ FISS tire des fils/ FILL », il n’y a pas d’ambiguïté sur le sens, donc pas d’ambiguïté sur la prononciation. Pas de problème de compréhension quand vous ENTENDEZ la phrase : « mon fils/ FISS tire des fils/ FILL » En revanche, quand vous la LISEZ, vous pouvez avoir un moment d’hésitation : « mon fils/ F.I.L.S tire des fils/ F.I.L.S ». Toute une mécanique mentale se met en place pour que le premier nom, je le prononce FISS et le deuxième FILL ; et s’il fallait traduire la formule dans une autre langue, dans la plupart des cas, on y perdrait le jeu sur la similitude graphique et la discordance sonore apportée uniquement par le sens ; en anglais, par exemple, on se retrouverait avec du son (this is my son) et du thread (I’ve lost the thread). Il eût fallu que je fisse des acrobaties pas possibles pour retrouver quelque chose qui me permît d’avoir deux sons et deux sens pour un même enchaînement de lettres.
Ils s’entremêlent, tous ces fils/ FILL, on ne peut pas tous les suivre – ces motifs ont quelque chose d’arachnéen – l’araignée tisse son fil ; voilà finalement un motif où nous autres traducteurs, mais aussi écrivains et lecteurs, pourrions nous retrouver. Je tends des filins d’un livre à l’autre, d’une traduction à une lecture. Je visualise une toile d’araignée dont chaque intersection est un livre, un livre lu par quelqu’un, écrit par quelqu’un, peut-être traduit par quelqu’un.
Toute lecture est un fil en soi (in itself), et si la toile que tisse l’araignée est en soie (silk), elle a pour fonction d’y attirer ses proies. Ce fil est la plupart du temps gluant, grâce à une colle biologique, je parle de celui de l’araignée. Quitte à filer à l’anglaise, et la métaphore, et au risque de m’emmêler, je pose la question : en quoi la ficelle qui relie une de mes traductions à une de mes lectures est-elle gluante ? Eh bien à deux titres : d’une part parce qu’elle fait coller deux livres entre eux, ou disons agglutine les livres deux à deux, or j’ai besoin que les livres se tiennent entre eux si je ne veux pas qu’ils tombent dans l’oubli ; et d’autre part parce que cette qualité collante permet l’adhésion à mon esprit d’éléments disparates : scènes de romans, répliques de personnages, sensations, couleurs, diversité de syntaxes et de situations. Donc à la fois fuir le bas et louer le collant.
Il y a autre chose : l’équilibre entre concentration, fatigue et énergie, qui fait que j’ai — ou pas — la force de lire, d’écrire, de traduire. Boxant sur le ring du lire-écrire-traduire, je suis renvoyé dans les cordes de la notion de culture. Il y a cette idée que pour traduire de la littérature, il faut avoir beaucoup lu. Mais on n’a jamais « beaucoup lu. Je ne sais pas ce que c’est que la culture. Et si je n’avais pas lu les trois romans suivants ? Le bal des folles, de Copi ; Mort aux girafes, de Pierre Demarty ; Un Corps tropical de Philippe Marczewski. Su je ne les avais pas lus, ma culture serait-elle KO, au tapis ? Ils semblent écrits en français, mais en réalité, chacun est composé dans une langue si dissemblable de la langue des deux autres qu’elles sont quasiment étrangères les unes aux autres, ces trois langues. En plus, pendant que je lisais ces trois livres, il y en avait des centaines que je ne lisais pas, que je n’écrivais pas, ne traduisais pas.
La plupart des livres, je ne les lirai jamais ; je n’ai rien lu. On parle de l’arbre qui cache la forêt, mais quid de la brindille qui obstrue la canopée ? de l’aiguille qui masque la botte de foin ? Mais foin de références sylvicoles, l’image de la brindille me botte parce qu’elle évoque aussi le fil – on dit bien « fin comme une brindille ». Et quitte à fouiner dans le foin, le fil, est-ce qu’on essaye de le faire rentrer dans le chas de l’aiguille ou pas ? Pas plus tard que la semaine dernière, je devais traduire feeding a thread thru a needle. Et ce que j’ai marqué – je rappelle que je tâche de parler de concentration et de fatigue – ce que j’ai marqué, donc avant de me relire et de me corriger, je vous assure que c’est vrai : « faire passer une fille dans le chat d’une église. » D’abord, on se demande ce que faisait ce félin à proximité d’un lieu de culte. En outre, une jeune personne, qu’elle soit de sexe féminin ou masculin, hormis peut-être par des techniques relevant de la pure magie ou de la téléportation, a de peu de chances de traverser sans encombre le moindre félidé. En tout cas, moi, je ne me fais pas à l’idée.
Je ne sais pas trop ce que c’est qu’une culture livresque, en revanche je vois ce qu’est un parcours de lecture : telle lecture m’a amené à telle autre, qui a conduit à telle traduction, laquelle m’a fait rebondir sur tel auteur, qui m’a éventuellement poussé à écrire un roman : dans mon cas, traduire Thomas Pynchon m’a effectivement amené à écrire un roman, La Dissipation : ça fait comme un circuit, un truc qui tourne 24 heures sur 24, dûment alimenté par les amis, les discussions, les critiques, les chroniques, la radio, le hasard.
A ce stade, je me rends compte que je ne vais pas avoir le temps de raconter en détails ma deuxième anecdote anglaise ; je vais me contenter de mentionner très rapidement ce qui s’est passé : l’action se déroule dans la région de Darlington, pour le mariage d’une autre cousine, la soeur aînée de celle qui nous a hébergés à Enfield. Nous sommes logés dans un château, loué pour l’occasion, digne de la famille écossaise de Bret Sinclair (Roger Moore) dans Amicalement Vôtre. Escaliers somptueux, boiseries, tentures, chambres luxueuses, immense parc avec tennis et, et, et : une bibliothèque. Dans la bibliothèque : cheminée, fauteuils en cuir, on devine l’odeur du thé, le tintement de la porcelaine, le nuage des cigares et du tabac fumé à la pipe, l’ébriété aristocrate, cognac, brandy. C’est parfait, me dis-je, je vais m’installer dans ce cadre luxueux, choisir un bon bouquin et lire, je lèverai par instant la tête pour voir le vent frissonner dans les arbres nobles du parc, tel Dany Wilde (Tony Curtis) rendant visite à l’oncle de Bret Sinclair, propriétaire d’une distillerie familiale cossue des Highlands. Et là, je vis une expérience inédite : je suis au milieu des livres, je parcours les rayonnages, reliures en cuir, il y en a des centaines, je survole les titres ; dans l’ensemble ce sont ce que l’on appelle des beaux livres, peut-être publiés à compte d’auteur avec la fortune familiale du château, en tout des livres vieux , à l’air vénérable, sans être non plus des livres anciens. Stupéfaction. Aucun de ces livres ne m’intéresse. Aucun ne me dit ‘Ouvre-moi, tu vas voir, ce sera bien.’ De même que mon fils n’avait nulle envie de lire les ‘histoires qui n’étaient pas vraies’. . . jusqu’à découvrir les maths, moi, dans mon manoir anglais, je suis rebuté par ces livres antipathiques. Pas un seul ne m’appétisse. Je suis face à des ouvrages qui ne semblent pas fait pour être lus par moi. Ça, ça ne m’était jamais arrivé. Ah si, finalement j’en trouve un. Un seul. Le livre s’intitule Psycho Geography, un texte de Will Self illustré de dessins de Ralph Steadman. J’en commence à le lire. Ensuite, les festivités ont lieu, (je rappelle qu’il s’agit du mariage de la cousine anglaise) nous restons deux ou trois jours sur place. Et au moment de repartir, de tourner le dos aux fastes de la vie de château, je constate que je n’ai pas fini la lecture de Psycho Geography. Alors qu’est-ce que j’ai fait ? Eh bien, je l’ai volé. J’avais besoin de l’embarquer pour le finir. De toute façon, il n’avait pas sa place dans cette bibliothèque. C’était le vilain petit canard, le seul ouvrage intéressant à mes yeux, mais qui jurait tant avec le reste de la collection. « Beaucoup d’autres meilleures choses, étaient à ma portée ; ce ruban seul me tenta, je le volai ; et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. On voulut savoir où je l’avais pris. » Ça, c’est Jean-Jacques Rousseau qui l’écrit, à propos de son fameux ruban volé. Moi, ce n’est pas un ruban que j’ai dérobé, c’est un ouvrage – et je ne me suis pas fait prendre. Don’t get me wrong, comme ils disent, qu’on me comprenne bien : je n’invite personne à voler les biens d’autrui – du reste, cela ne m’est arrivé qu’une seule fois, et dans les circonstances uniques que je viens d’exposer. Tel un commando du Mouvement de Libération des Nains de Jardin, j’ai libéré ce Will Self de la geôle dorée où il croupissait. Contrairement à Jean-Jacques, je n’en conçois pas de remords particulier. On se souvient que Rousseau, accusé d’avoir volé un ruban faisait accuser une domestique et était ensuite accablé de culpabilité, un poids resté sans allégement sur sa conscience ; le désir de s’en délivrer en quelque sorte ayant beaucoup contribué à la résolution qu’il a prise d’écrire ses confessions. (ce sont ses mots).
Où voulais-je en venir ?
Récapitulons. Mon fils qui n’a jamais lu un roman se retrouve plongé dans des opus de mille pages couverts de « phrases » hermétiques qui le font vibrer – il joue à faire des exercices ; une bibliothèque anglaise entière ne contient qu’un seul livre susceptible de me faire frémir. Peut-être n’y a-t-il pas de culture mais des trajectoires de lecture, des enfilades de livres lus, qui forment quelque chose comme la double hélice de la structure secondaire de l’ADN bicaténaire ; au fil des livres que je traduis, je suis l’araignée qui tisse des lianes en hélices.
Arachnéen : qui est propre à l’araignée. Au sens figuré : qui est semblable à la toile d’araignée, qui en a la légèreté. Les frères Goncourt dans leur Journal (1889) évoquent la structure arachnéenne de la Tour Eiffel, par exemple. Le mot de la fin, je pourrais presque le chanter, comme un hymne :
Je ne suis pas une spécialiste / Je ne suis pas une communiste / Je ne suis pas une cycliste /Je ne suis pas une catholique / Je ne suis pas une footballiste / Je suis une traductiste / Je me dis juste Putain putain / c’est vachement bien / Nous sommes quand même tous / des arachnéens.
Je ne suis pas une spécialiste / Je ne suis pas une cycliste / Je ne suis pas une footballiste / Je suis une traductiste / Et je me dis juste Putain putain / c’est vachement bien / Nous sommes quand même tous / des arachnéens.
Nicolas Richard




Cet article est soumis à la loi sur la reproduction. Autorisation à demander à traduqtiv@gmail.com
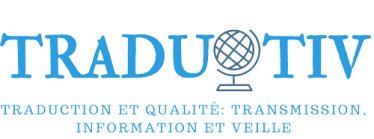

Oh mais quel discours d’anniversaire fabuleusement tissé ! Et c’est tellement çà : « en quoi la ficelle qui relie une de mes traductions à une de mes lectures est-elle gluante ? » Ju-bi-la-toire ! Merci de partager ce B-Day special gift !
(NB : je viens de terminer « Par instants, le sol penche bizarrement », et je viens illico de recommencer à le lire tellement c’est un régal pour les neurones et les zygomatiques)
J’aimeAimé par 1 personne
Très savoureux.
Moi qui suis trop flemmard pour traduire autre chose que des poèmes courts (avec une appétence particulière pour les sonnets: 14 vers, c’est à la traduction poétique ce que le 200 m est au marathon) je compatis aux efforts des vaillants traducteurs de volumineuses proses (souffrez que je les admire et ne les imite point).
J’aimeJ’aime